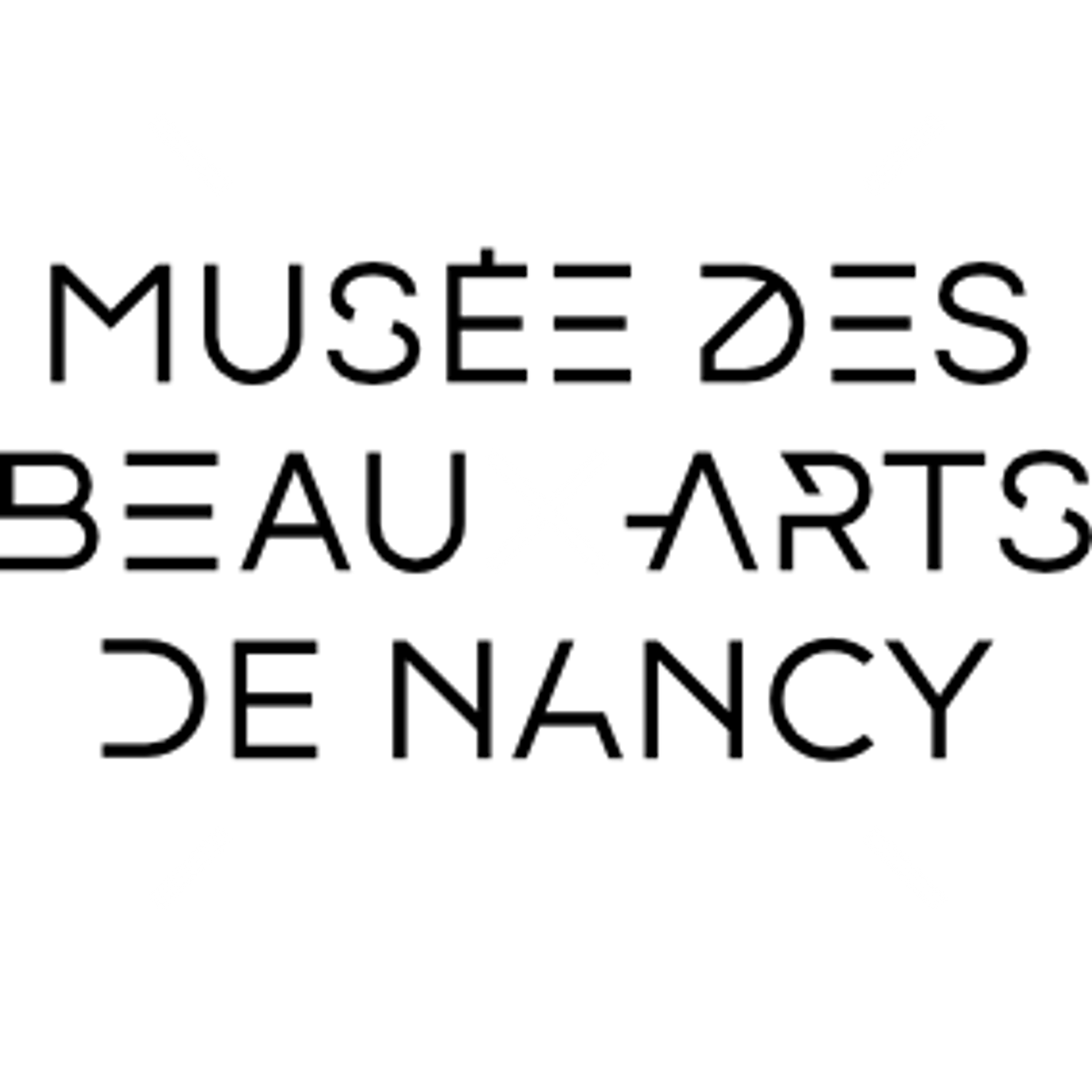La gravure d'ornement
L’ornement est un sujet qui cristallise autour de lui un débat pluriséculaire. Certains le considèrent comme élément essentiel, puisqu’il est là pour embellir et produire un sentiment de bien-être chez celui qui le regarde, d’autres vantent son inutilité et sa superficialité. L’estampe d’ornement, un genre bien particulier qui apparaît dès le XVIe siècle, permet de proposer une approche pacifiée de cette notion. En tant qu’objet de collection, elle ravit les partisans du « beau inutile », et comme source d’inspiration ou modèles pour les différents corps d’artisans, elle affirme son caractère utilitaire. La collection Thuillier possède un très bel ensemble d’estampes d’ornement du XVIIe siècle, où se côtoient les grands ornemanistes de la période (Jean Lepautre, Antoine Pierretz), mais également quelques artistes moins connus, dont l’œuvre mérite une attention tout aussi importante, qui vient ainsi orner le cabinet d’arts graphiques du musée.