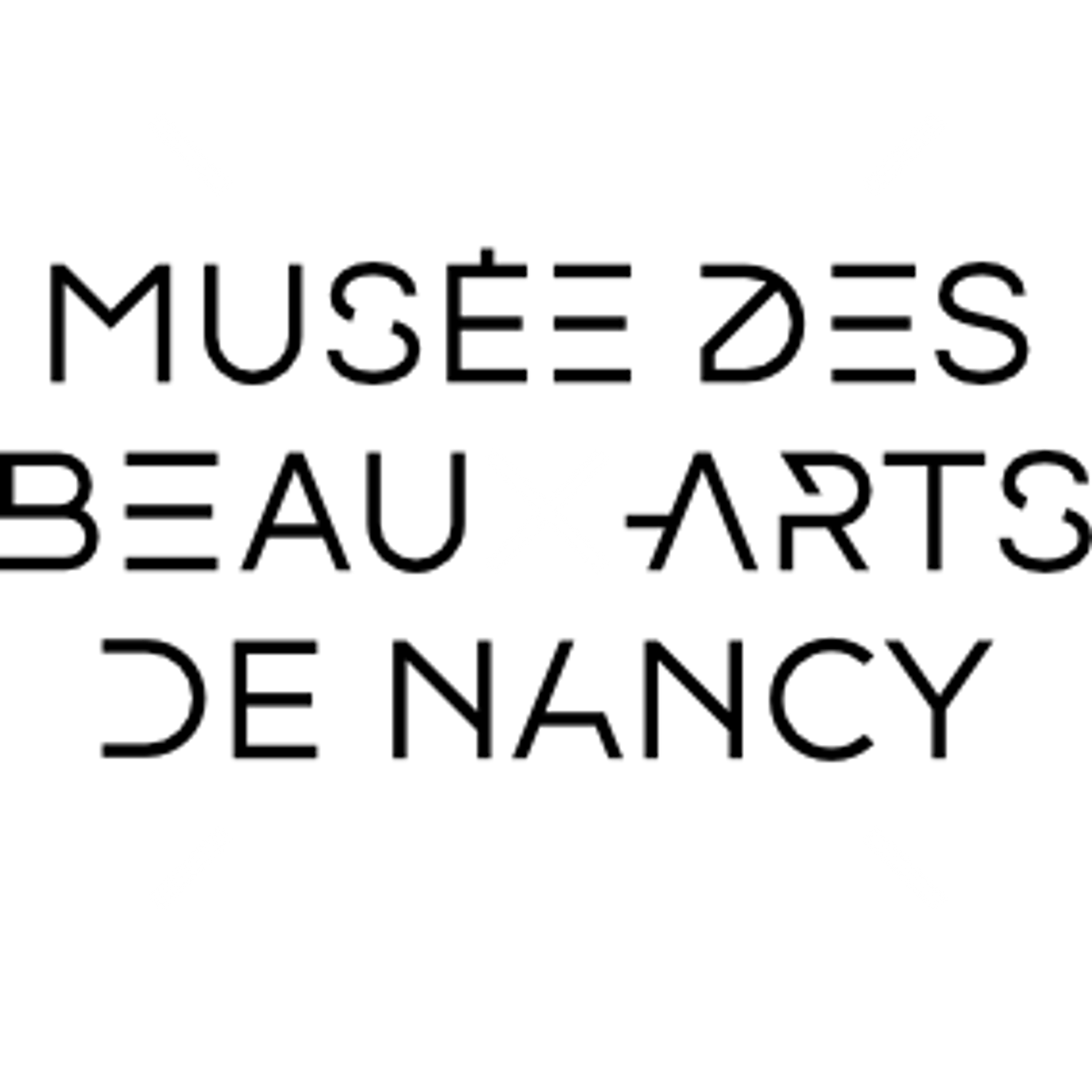L'Annonciation - Pourbus Frans II
Domaine
Peinture
Peintre
Pourbus Frans II
- Lieu de naissanceAnvers
- Date de naissance1569
- Lieu de décèsParis
- Date de décès1622
- Notice biographiquePeintre de portraits. Fils de Frans I Pourbus et de la fille de Cornelis Floris. Comme portraitiste, il fut le chef de file de sa génération dans les cours européennes. Si P. Pourbus et son fils Frans avaient su imposer leur art à un niveau régional, Frans le Jeune, par la qualité exceptionnelle de ses portraits, a étendu la renommée des Pourbus à l'Europe entière. Un petit tableau, signé et daté, témoigne de ses talents précoces. A la mort de son père, en 1581, il hérita de ses dessins. Son grand-père, Pieter Pourbus, compléta sa formation à Bruges. Durant cette courte période, il semble avoir subi l'influence décisive de la peinture froide de celui-ci, ainsi qu'en témoigne son œuvre de jeunesse, en particulier quelques portraits, signés et datés 1591 ou 1592, notamment celui de "Frans Francken" (Florence, Uffizi) et celui de "Pierre Ricart" (Bruges, Groeningemus.). En 1589, il restaura le triptyque du "Calvaire" de Bernard van Orley pour l'église Notre-Dame à Bruges, où il se trouve encore actuellement. En 1591, il est inscrit comme maître à la gilde des peintres d'Anvers. Dès l'année suivante, il eut une élève, Fernande. En 1594, ses biens immobiliers, ainsi que ceux de sa famille, furent vendus publiquement. Suite à cela, il dut entrer au service des archiducs et s'installer à Bruxelles. Il réalisa plusieurs portraits d'apparat importants des archiducs, qui furent répandus par des copies. Son style conjugue alors la manière de ses ancêtres et celle des peintres de la cour espagnole, tels que Pantoja de la Cruz et Alfonso Sanchez Coello. Elle se caractérise, d'une part, par une attention soutenue pour le détail et l'étiquette de cour, de l'autre, par une grande précision dans le rendu des physionomies. A l'été 1599, lors de son séjour aux Pays-Bas espagnols, Vincent de Gonzague l'invita à travailler à la cour de Mantoue. Lorsque Pourbus arriva à Mantoue un an plus tard, P.P. Rubens venait, lui aussi, d'être engagé comme peintre de la cour des Gonzague. Ils deviendront des amis intimes, ainsi qu'en témoigne le "Portrait de groupe" de Rubens (Cologne, W.R.M.). Pourbus, comme portraitiste de renom, semble avoir joui de la faveur de ses commanditaires. Vincent de Gonzague l'envoya à Innsbruck (1603), Prague (1605), Paris (1606), Naples (1607) et Turin (1605/1606 et 1608), notamment pour y peindre les portraits des beautés des cours européennes destinés à compléter sa "Galerie des belles femmes". En 1606, il était à Paris où il fit le portrait de Marie de Médicis et du prince héritier Louis. En 1607, il tenta d'acquérir deux œuvres du Caravage pour les collections mantaises, dont la "Madonne au rosaire" (Vienne, Kunsthist. Mus.). Lorsqu'en septembre 1609, il revient à Paris, sa période italienne semble définitivement close. Selon L. Burchard, Pourbus le Jeune avait alors atteint l'apogée de son art. A cette époque, il était devenu un modèle à suivre pour beaucoup de peintres de cour en Europe. En France, il réalisa les portraits de Marie de Médicis et d'autres membres de la famille royale. Dans un premier temps, il envisagea de retourner à Mantoue, mais il continua à travailler comme peintre de la reine au service de Marie de Médicis qui, de 1610 à 1614, assurait la régence en qualité de reine-mère. Il peignit également des portraits de bourgeois, tel celui de "Martin Ruzé", alors âgé de 83 ans (1612). En 1614, il peignit pour l'hôtel de ville de Paris deux portraits de groupe de très grandes dimensions, comprenant les doyens et les échevins de la ville. Pourbus habita Saint-Germain-des-Prés. Le 21 janvier 1614, dans l'église paroissiale Sainte-Elisabeth, fut baptisée sa fille naturelle qu'il eut d'Elisabeth Francken. Lors de l'avènement de Louis XIII, il semble être passé à son service sans problèmes notoires. En 1616, il signait "peintre du roi" les portraits du souverain et de sa mère. D'après des documents datant de cette année, il semble qu'il soit nommé "peintre ordinaire du Roy". En 1618, une pension annuelle lui fut allouée en qualité de peintre du roi. La même année, il fut naturalisé français. A partir de ce moment, il disposa d'un atelier au Louvre et forma de nombreux élèves. Selon Baldinucci, J. Sustermans aurait travaillé deux ans chez Pourbus avant de regagner Florence. Toujours en 1618, Pourbus peignit sa grande "Cène" pour l'église paroissiale de Saint-Leu-et-Saint-Gilles (Paris, Louvre). Cette composition monumentale fut suivie d'une "Annonciation" (1619) et de la "Stigmatisation de saint François" (1620), œuvres destinées à l'église des Jacobins (act. Nancy, M.B.A. et Paris, Louvre). Précédemment, il avait réalisé l'imposante "Vierge de la famille de Vis" (Paris, égl. St-Nicolas-des-Champs). Quoique son œuvre historique semble être limitée en nombre, Pourbus s'y montre néanmoins un précurseur marquant du classicisme de Philippe de Champaigne et de Nicolas Poussin. En France, le style des portraits de Pourbus s'était rapidement adapté au style ambiant. Son œuvre perdit de sa monumentalité mais la touche devint plus picturale. Pourbus fut également actif comme peintre de portraits miniatures. Cette partie de son œuvre pose toutefois encore des problèmes. Le 19 février 1622, il fut enterré dans l'église des Augustins au faubourg Saint-Germain. Il aurait conçu le projet de retourner à Mantoue au printemps. Avec lui s'éteint une lignée de peintres célèbres.
Date de création
1619
Désignation du bien
L'Annonciation
Inscriptions / marques
Signature et date
F. POURBUS FECIT ET EX PARTE DEDIT.AN.SAL.M.VIC.XIX.(sur l'estrade)
en bas à gauche
Mention
ECCE ANCILLA DOMINI (en lettre d'or devant la bouche de Marie)
en bas à gauche
Libellé
Huile sur toile
Mesures
H. en cm : 398
L. en cm : 270
H. avec le cadre en cm : 415
L. avec le cadre en cm : 283
Epaisseur avec le cadre en cm : 9
Description
Né à Anvers, réclamé par toutes les grandes cours européennes pour ses qualités de portraitiste, Pourbus Le Jeune s’installe à Paris à partir de 1609 au service de Marie de Médicis, puis d’Anne d’Autriche. Cette Annonciation, sobre et monumentale, peinte pour l’église des Jacobins à Paris, au tout début du XVIIe siècle, préfigure la rigueur du classicisme français.
Bibliographie
Claude Pétry, Le Musée des Beaux-Arts de Nancy, Coédition Musées et monuments de France, Ville de Nancy et Albin Michel, Nancy, 1989
Claude Pétry, Le Musée des Beaux-Arts de Nancy, Coédition Musées et monuments de France, Ville de Nancy et Albin Michel, Nancy, 1989
p.44
Salmon Béatrice (dir.), Collection du musée des beaux-arts de Nancy. Regards, Réunion des musées nationaux, 1999
Salmon Béatrice (dir.), Collection du musée des beaux-arts de Nancy. Regards, Réunion des musées nationaux, 1999
p.92
Blandine Chavanne (dir.), Eclats : Collection du musée des Beaux-arts de Nancy, Somogy, 2005
Blandine Chavanne (dir.), Eclats : Collection du musée des Beaux-arts de Nancy, Somogy, 2005
p. 86, ill.
Exposition
p. 362, ill. p. 363
L'Automne de la Renaissance : d'Arcimboldo à Caravage Nancy, Musée des Beaux-Arts, 4 mai - 4 août 2013
Acquisition
2008 Transfert de propriété Etat
Notes
Dépôt de l'Etat de 1804, transfert de propriété de l'Etat à la ville de Nancy, 2008
Photographe
Cliché Claude Philippot
Numéro d'inventaire
101
Sujet / thème
Histoire religieuse
Personne représentée
Vierge
Gabriel archange
Facettes
Cliquez sur un terme pour voir toutes les œuvres de nos collections associées à ce dernier.